« Les derniers jours du Parti socialiste » d’Aurélien Bellanger : sauver l’Histoire
Si la force d’un roman se mesure à l’incompréhension qu’il suscite, Les derniers jours du Parti socialiste est une œuvre de première importance. Répercutant son incipit, on dirait qu’à son propos « tout a été dit ». La raison en est qu’Aurélien Bellanger endosse une responsabilité dont le public s’était déshabitué. Voilà en effet un type d’engagement qui, de cliché au milieu du xxe siècle, est devenue une exception quand le reste de la profession lui préfère des registres plus personnels.
Illustration : Aurélien Bellanger © Photo Manuel Braun
Cette littérature à la première personne peut désactiver par avance le commentaire quand la confusion du sujet et de l’objet est telle que le lecteur fait l’expérience d’un livre irrémédiablement clos sur lui-même. Or le commentaire, loin d’être le propre du critique, nourrit d’abord la joie du lecteur que l’auteur considère assez pour livrer un écrit qui rende possible deux parts actives dans le phénomène romanesque. Autrement dit, une telle lecture, sans rien modifier de la matérialité du roman, devrait pouvoir le coiffer, l’achever, ou l’auréoler. Ici, par contraste avec la littérature solipsiste, et dans la mesure où se dresse entre eux deux un objet, l’auteur s’adresse au lecteur comme à un autre sujet, comme s’ils pouvaient communiquer dans une langue commune, en un lieu partagé, selon des repères connus. Comme s’ils faisaient partie d’une même histoire. À suivre les malentendus autour de sa réception, l’attention qui est due à ce roman est justifiée par le fait que ce « comme si » s’avère un pari loin d’être gagnable. Car c’est bien dans le creux d’un défaut d’être-historique, défaut qui est tout à la fois l’horizon, la menace, l’objet et l’arrière-fond du roman même,que ces Derniers jours font entendre des questions pressantes.

Aurélien Bellanger, dans sa période chevelue © C. Hélie – Gallimard
Pour ce qui concerne la fonction du romancier dans la réactualisation de l’être-historique de la littérature, on ne saurait paraphraser Aurélien Bellanger quand, à propos du personnage qui se trouve devant l’histoire dont il est le contemporain dans l’exacte position du lecteur face au roman — l’un et l’autre ne pouvant raisonnablement espérer une meilleure part active que celle qui consiste à achever, en le comprenant, l’objet (l’histoire, ou le roman) pour le faire courageusement perdurer (agir, ou commenter) — il dit de lui
« [qu’]il se protégeait alors derrière la théorie selon laquelle Balzac n’ayant jamais touché au pouvoir suprême, La Comédie humaine était entièrement structurée par cet interdit fondamental. » (p. 293)
Qu’est-ce qu’un « interdit fondamental » qu’on verbalise seulement dans le creux du roman, en sa moitié, avec peut-être le souhait d’être à peine entendu ou (peut-être, aussi) l’intention que, l’ayant placé au centre, le propos redéfinisse de façon subliminale les modalités de l’attention du lecteur ? Et de quoi relève une telle façon d’écrire sinon de l’instinct premier de la religion : dire ce qui ne peut, mais doit être dit, ce qui ne peut, mais doit être entendu ? « Il convient de garder le secret du roi, tandis qu’il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. » (Tb 12:7) Dans le contexte du livre de Tobie, le conseil de l’ange Raphaël aux jeunes époux ne s’insère dans aucun développement proto-laïque ; ce n’est pas un Rendez donc… avant l’heure, mais une comparaison qu’avant rien ne suggère et qu’après rien ne poursuit. Quel rapport possible, en effet, entre des noces bénies par l’ange de Dieu et le secret d’un roi ? Entre le bonheur privé et l’intérêt général ?

Fait assez remarquable parmi les livres bibliques, aucun enjeu politique ne traverse l’histoire de Tobie. Que vient donc y faire le roi ? Textuellement, une irruption qui surprend la lecture et la met en défaut. Cette incartade dans le texte demande au lecteur s’il laissait défiler une suite de mots dont il peut grossièrement connaître l’enchaînement parce qu’il devine le sens du récit — l’histoire d’un homme que l’ange Raphaël donne comme époux à une femme dont les sept premiers prétendants sont morts, frappés par le démon, avant d’avoir pu l’approcher —, ou s’il est capable d’y prêter une attention vierge de préjugés. Et même à supposer que ces paroles de l’ange soient seulement une occurrence du parallélisme (le secret / du roi // publier / Dieu) typique de la rhétorique sémitique, il faut encore rendre compte du fait que cette seule phrase contienne, sous une forme archaïque, une opposition qui traverse Les derniers jours du Parti socialiste qu’on lira comme le roman de la laïcité[1].

L’article de Max Goldminc sur Aurélien Bellanger dans « Huis-Clos # 6 » © Huis-Clos
Ce roman n’a pas pour seul mérite de mettre en texte des problèmes à densité biblique. L’auteur s’y distingue par sa capacité à écrire d’après plusieurs niveaux de sens — à commencer par les registres ésotérique et exotérique dont l’articulation est une caractéristique commune au discours politique et à la parole religieuse, domaines dont le voisinage est délibérément exposé à l’incipit du roman[2] — et des dimensions thématiques écartelées (le ridicule des desseins des personnages politiques et la tragique importance de leurs actions, le délabrement par la presse du mode de pensée philosophique et la persistance de l’esprit dans l’histoire). C’est cette sombre virtuosité qui explique à la fois son retentissement et sa réception paradoxale. Le désir balzacien de l’auteur est bien connu de ses lecteurs et pourtant, quelque chose s’est passé, comme si un quatrième mur avait été brisé. Il ne s’agit pas, ici, d’une sucrerie pour les connaisseurs : l’auteur a écrit un roman si vivant qu’il mène sa propre vie hors du livre, tandis qu’à l’intérieur du livre soufflent des vents contraires, des phénomènes littéraires et non-littéraires. Comme l’a découvert Erich Auerbach dans sa somme critique sur la littérature occidentale,
« l’enseignement central du christianisme, la doctrine de l’Incarnation et de la Passion, était incompatible avec le principe de la séparation des styles[3]. »
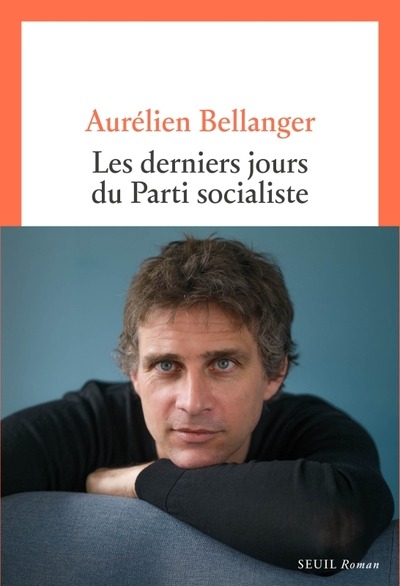
« Les derniers jours du Parti socialiste » par Aurélien Bellanger © Éditions du Seuil
De fait, si le temps des rois est révolu, nous sommes encore, « pour un peu de temps encore », dans celui de la politique et, dans l’espoir et l’orgueil de celle-ci, du politique ; reste un même secret jalousement gardé, jamais si bien qu’en ces temps où, selon un instinct précisément politique, la réception majoritaire d’un livre qui se mêle de cela seul qui le regarde, objecte à grands cris sérieux qu’un romancier ne devrait pas s’en mêler, pas s’emmêler. Confusionnisme, cryptoislamogauchisme, militantisme, fautes de goût. On sait que le goût, à plus forte raison s’il est fragile et incertain comme le goût présent, ne souffre aucune offense. Mais comment un romancier pourrait se confronter à l’histoire contemporaine s’il en évacuait d’emblée le ridicule ? Ne serait-ce pas bien plutôt le secret de l’histoire présente que Grémond essaie de saisir ?
« Qu’un courant trotskiste ultraminoritaire se scinde en deux entités pouvait paraître ridicule, mais ce n’était pas autrement que l’histoire universelle, à pas de loup, avait connu ses plus beaux progrès. Grémond, sur ce point, ne varierait jamais. » (p. 20)
Est-ce là une conception propre au personnage ? Les développements ultérieurs du roman nous montrent au contraire que le narrateur, sinon l’auteur, travaille avec cette idée. Dans Les derniers jours du Parti socialiste, le ridicule n’est donc pas qu’un registre qui donne aux dialogues leur densité et leur tragique aux caractères de Grémond, Taillevent, Frayère et Revêche : c’est un pari d’historien, une grille d’analyse pour rendre compte de ce qui s’est passé. Là réside à mon sens la singularité du roman et sa portée intellectuelle qui, par ailleurs, prolonge naturellement l’œuvre d’Aurélien Bellanger dont les romans précédents avaient aussi à cœur de chroniquer le XXIe siècle en opérant un détour millimétré par rapport aux faits bruts tels que la presse peut en rendre compte.

François Mitterrand, 1er mai 1979 © Wikipedia Commons
On lit partout que l’auteur s’est montré satirique, comme si c’était une facilité. Il semble au contraire que le roman le serait plus franchement s’il racontait avec sérieux l’histoire politique la plus récente : dans ce cas, chacun aurait un accès immédiat à l’hilarité, comme devant des statues de cire en décomposition. Mais Aurélien Bellanger est ici comique comme Molière, comme Beaumarchais : les personnages les plus sérieux, les plus fiers (Taillevent, Frayère, Revêche) sont, pour le lecteur, les plus drôles, et les situations les plus drôles (le dîner mondain chez Revêche à La Varenne Saint-Hilaire), les plus préoccupantes.
Dans la réalité, tout indique qu’on ne peut s’attarder sur les phénomènes historiques sans être bardé d’un certain sens de l’humour. Le style politique joue en effet sur les mêmes ressorts que l’humour (peut-être de façon plus accusée dans l’histoire récente) : la répétition, la simplicité du volontarisme, l’impératif d’adaptation, le brusque retournement des situations qui signe la chute du mot d’esprit et celle de l’homme politique. En ce sens, rien n’est plus drôle que la politique, intuition que l’industrie de la satire (de Charlie Hebdo aux Guignols de l’info et au-delà) s’est accaparée au point d’entraîner la dissociation, dans la culture, de l’humour et de la politique. De sorte que si la critique actuelle, au bon souvenir de ses classiques, était disposée à accueillir un roman politique ou historique, elle en attendait le plus grand sérieux.

Jack Lang, figure du socialisme en France © Wikipedia Commons
Le ridicule borne le récit comme les rappels d’une couleur sur une grande fresque. Grémond entre en politique à l’époque mitterrandienne, quand l’ironie du socialisme gouvernemental jetait un premier souffle glacial sur la fièvre de 68[4]. Taillevent défie Paris comme un Rastignac de troisième zone[5]. Revêche se réserve une place confortable dans l’histoire de l’Esprit[6]. Frayère se fait une si haute idée de lui-même qu’il se présente comme une pure abstraction politique[7]. Ces quatre personnages sont comme maculés de ridicule. Mais un cinquième, plus discret dans le livre comme son probable modèle dans la réalité, en assume la portée politique, voire programmatique : Bénédicte Levasseur, alias Bébé, « l’un des personnages les plus balzaciens du Paris d’alors » (p. 301), ancienne patronne de presse, néo-Tocqueville : « Son unique matière, celle qu’elle sculptait comme personne, c’était l’envie. Mais il fallait, notamment en travaillant à rendre les élites un peu ridicules, que celle-ci demeure à un niveau supportable. En cela, Bébé exerçait réellement une fonction interlope. Il était de son devoir, ne serait-ce que commercialement, car il fallait bien qu’on achète son journal, de maintenir, entre l’élite et le peuple, les conditions d’un dialogue possible. Et si les puissants toléraient cette exhibition permanente d’eux-mêmes, c’est qu’ils avaient bien compris cela, ou qu’elle le leur avait expliqué. La presse people, disait Bébé, est la seule méthode efficace de gouvernement démocratique. » (p. 305, je souligne)
Un autre personnage endosse la responsabilité du premier degré au risque du ridicule. Les lecteurs du roman comprendront que dans le cas de Sauveterre, le ridicule n’est plus un défaut ni même une faute, c’est un aspect de l’existence, à plus forte raison de l’engagement. Pour ne rien enlever au plaisir des prochains lecteurs, je ne peux pas démontrer plus directement en quoi consiste le ridicule particulier de Sauveterre. Figure messianique et pourtant très humaine, est ce point chaud de lucidité qui voudrait entrer en contact avec la planète courage. Éprouvé par une mauvaise conscience bourgeoise, il revient à la gauche. Cet engagement lui fait voir que le détachement n’a rien de neutre, qu’il s’agit d’une pression continue sur les boutons de l’ironie et de la distance coupable[8]. S’en libérer, c’est accepter par avance le stigmate du ridicule. Une épreuve à traverser pour revenir à l’histoire, recouvrer une dignité et se défaire des vieux habits de la « littérature officielle » (p. 299). Tobie encore et enfin, quand cet engagement s’accompagne d’une plongée dans la spiritualité qui convoque Sauveterre devant la double instance du secret du roi et des œuvres de Dieu[9].
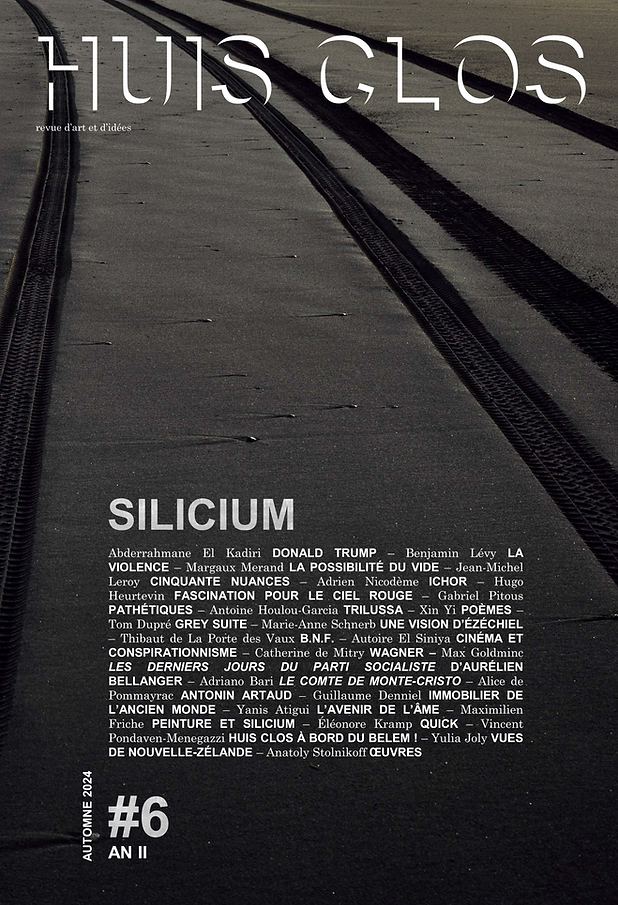
Le sixième numéro de Huis-Clos, dans les meilleures librairies, notamment germanopratines © Huis-Clos
Les événements, les personnages, leurs ambitions et leurs dialogues, tout, dans Les derniers jours du parti socialiste, est terrible et ridicule, bizarre et tragique, histrionique et menaçant. C’est le prix qu’un roman doit payer pour sauver l’histoire.
[1] Cette même laïcité qui serait, selon Grémond qui peut surjouer l’ésotérisme, « la vraie forme des États modernes, leur constitution cachée » (p. 310).
[2] « [Le mouvement du 9 décembre] appartient désormais à l’histoire politique de la France — sinon à son histoire religieuse. » (p. 9)
[3] Erich Auerbach, Mimésis, Gallimard (1992), p. 82
[4] « Ceux qui, devenus ministres, se moquaient de ce basisme […] » (p. 19)
[5] « Taillevent, c’était tout son charme et tout son ridicule, croyait que Paris était encore le défi principal qui attendait les héros de notre temps » (p. 169)
[6] « Et nous demeurons à l’intérieur de cette histoire spirituelle de l’Occident, dont nous sommes un moment » (p.195)
[7] « Frayère le répétait toujours, c’était devenu sa marque de fabrique : “Je ne suis pas de gauche, je suis la gauche, la vraie gauche, celle qui n’a pas renoncé à être elle-même.” » (p. 389)
[8] « Il tenta de s’en expliquer dans quelques chroniques ambiguës. Cependant l’exercice de l’ambiguïté ne lui permettait plus, alors qu’il l’avait cru jusque-là universel, d’exprimer sa pensée. » (p. 313)
[9] « Les choses prient un tour encore plus inattendu, quand, derrière une barrière anti-émeute, les yeux fixés sur la procession infinie des pauvres recouverts de leurs chasubles dorées, il se découvrit non pas révolutionnaire, mais catholique. » (p. 313)
Si vous ne connaissez pas encore la revue Huis-Clos, découvrez-là ici



