Rencontre avec Quentin Ebrard, auteur d’un premier roman
Quentin Ebrard est un jeune romancier dont le premier roman Pourvu que mes mains s’en souviennent vient d’être publié aux éditions Belfond. Journaliste de formation, il est un influenceur littéraire avec plus de 11 000 abonnés sur différents réseaux sociaux. Passionné de lecture, Quentin Ebrard est venu à l’écriture dès les années collège. Son livre au titre énigmatique connaît un vif engouement auprès des libraires et est recommandé par de nombreux lecteurs.
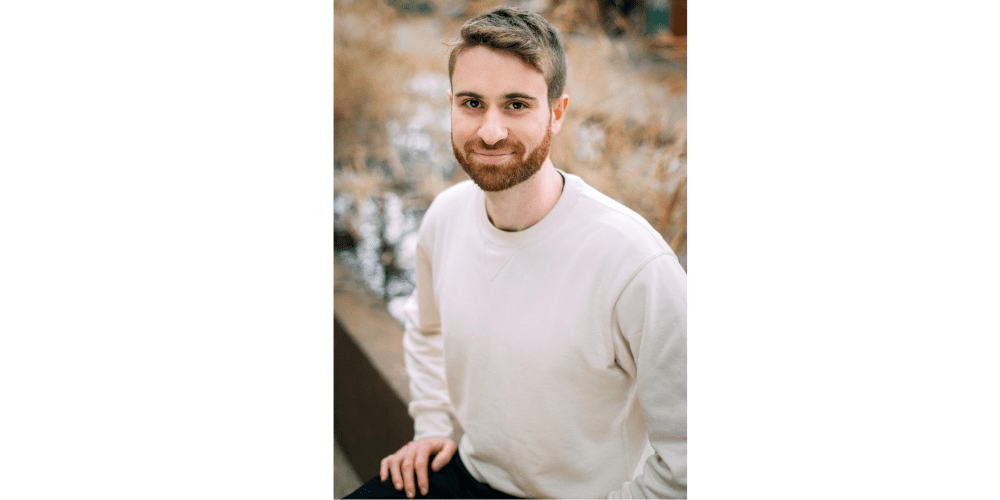
Votre premier roman invite à la découverte d’une héroïne Louise qui se rebelle contre son lieu de vie où elle serait enfermée. Il y a de nombreux secrets autour de Louise, certains événements semblent même lui échapper.
Louise est très déterminée et opiniâtre. Elle s’estime prisonnière d’une colonie de vacances assez effrayante, angoissante où les monos sont parfois rudes, violents. Là où il devrait y avoir des cris d’enfants, de la joie, il y a plutôt de la lassitude, de l’ennui. Et Louise veut absolument s’enfuir et retrouver ses parents, c’est son obsession. Elle a un plan qu’elle va appliquer de façon méthodique. Ce plan complètement fou est de s’enfuir par les airs en construisant un deltaplane. Louise sait qu’elle peut le faire et qu’elle l’a déjà fait mais sans savoir pourquoi. Elle embarque dans cette aventure deux camarades qui sont très attachants comme elle. Sa meilleure copine Juliette est fragile, plus difficile. Il y a un garçon qui est secrètement amoureux d’elle, et qui est le bricoleur de service. Au départ, il y a cette histoire en apparence un peu enfantine, joyeuse, mais qui nous entraîne dans une sorte de fable. Plus les pages avancent et plus on se rend compte que ce qui se passe n’est pas vraiment ce qui se passe. Il y a une chute qui a bouleversé beaucoup de monde et qui j’espère bouleversera de nouveaux lecteurs.
Justement on ne sait pas si l’étrange château où vivent Louise et ses camarades est une colonie de vacances ou même un hôpital psychiatrique. On ne sait pas non plus si le récit se déroule dans les années 1950, 1960 ou à une période plus récente. L’identité des personnages paraît trouble, c’est un choix délibéré ?
Oui c’est un choix délibéré et assumé. J’aime les romans qui nous mènent dans des lieux qui paraissent proches de nous et dont le récit pourrait se passer dans le coin de la rue. Je floute les bords pour permettre une sorte d’universalité pour qu’on puisse lire ce livre autant aujourd’hui qu’hier ou demain. Ce qui compte pour moi c’est l’émotion que ressentent les gens. Mes romanciers fétiches sont Boris Vian, Eric-Emmanuel Schmitt, des auteurs qui abordent les grands sujets de société avec profondeur mais sous l’apparence d’histoires qui sont souvent hors temps et qui pourtant nous touchent. Et puis c’est vrai qu’il y a une obscurité, un trouble qui est aussi voulu par l’histoire des personnages.
La lecture est plutôt progressive, inattendue avec des fragments de vie qui surgissent. Et on continue à s’interroger jusqu’à la chute. C’est un exercice assez difficile d’accompagner dans le suspense le lecteur.
Un journaliste a dit que c’était un jeu d’illusionniste.
Vous portez un regard humaniste sur ces personnages, sur Louise en particulier qui est très libre et même affranchie.
Un des travers du cinéma et parfois du roman est peut-être une vision trop manichéenne. Mes personnages sont comme dans la vie, il y a des points de vue, différentes approches. Le romancier doit se glisser dans la complexité de toutes ces peaux. Un des personnages, Joël, un des moniteurs qui clairement est un antagoniste car il flique Louise, dès qu’elle s’enfuit il la rattrape. Il met des claques sur le dos, sur les épaules. C’est le mono qu’on a pu rencontrer en colonies et qui a des excès de pouvoir. Et finalement à la fin du roman, on se rend compte que c’est plus compliqué. J’apprécie les retournements de situations : on peut détester un personnage pour prendre conscience que ce n’était qu’une question de point de vue. Donc l’humain au centre, oui c’est très important.
Ce qui est intéressant c’est que vous avez décloisonné, les personnages ne sont pas assignés dans des rôles.
Ils ne sont en effet pas dans des rôles déterminés et je suis convaincu que le lecteur co-écrit autant le roman que le romancier. Dans les zones d’ombre, le lecteur construit son imaginaire et ces personnages-là laissent une marge d’appréciation. Le lecteur est intelligent, il ne faut pas le cadrer, il avance en même temps que l’histoire. Il faut des portraits très forts mais qui laissent aussi une place au rêve.
Les livres, c’est une grande passion pour vous. Vous êtes aussi un « bookstagramer » – un influenceur dans le monde des livres.
Bookstagram, c’est venu à côté. Quand on écrit c’est un long chemin, on se heurte au refus des éditeurs. On est très seul. Vos proches vous demandent où vous en êtes dans vos projets. Bookstagram c’est venu de mon goût de la lecture. Mes chroniques ont bien pris et j’ai atteint un nombre intéressant d’abonnés. En fait, j’écris depuis la classe de Cinquième, j’ai commencé dans des carnets. J’étais scolarisé dans un collège de ZEP (Zone d’éducation prioritaire) à Montpellier, au collège Les Garrigues à La Paillade-Mosson. Il y avait une prof de français qui avait des difficultés avec la classe, avec des problèmes d’autorité terrible, les élèves étaient très turbulents. J’étais plutôt bon élève et un jour elle m’a dit : « Quentin pour affiner ton écriture, tu devrais écrire dans des journaux intimes et noter ce que tu penses. Ça va t’aider tu verras, c’est génial l’écriture. » J’avais onze, douze ans, j’ai senti les ricanements autour de moi et j’ai rejeté ce qu’elle disait pour ne pas subir de remarques. Et le soir-même, j’ai pris un carnet, j’ai commencé à écrire ma journée et ça a été un coup de foudre pour l’écrit. Juste poser ses pensées, c’est un espace de liberté absolu. Les résumés de la journée se sont transformés en poésie, en courts textes, en nouvelles et aujourd’hui en roman. Et c’est vraiment grâce à elle que j’ai pu basculer dans l’écriture.
Propos recueillis par Fatma Alilate.
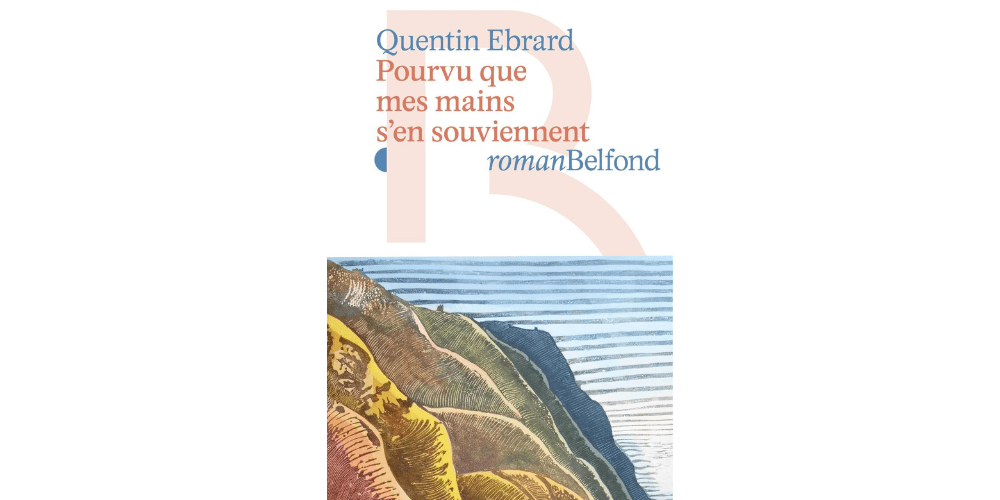
Pourvu que mes mains s’en souviennent de Quentin Ebrard, 192 pages, 20 € – Belfond.



